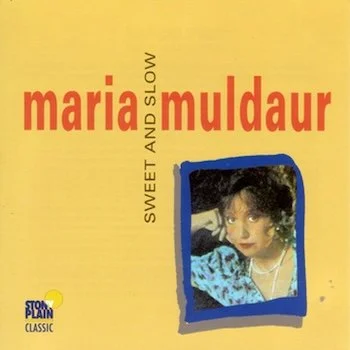Maria Muldaur
Entre blues, sensualité et folk spirituel
Il y a dans la voix de Maria Muldaur quelque chose d’infiniment fluide, de chaud et d’espiègle : une manière d’habiter le blues et la folk avec cette grâce terrienne, à la frontière du sacré et du charnel. Née à New York en 1943, Maria D’Amato — son nom de naissance — grandit dans le Greenwich Village des années 1960, creuset de la renaissance folk américaine. Dans cette scène où se croisent Bob Dylan, Dave Van Ronk et Joan Baez, elle s’impose d’abord comme une jeune chanteuse fascinée par le blues traditionnel du Deep South et par les musiques afro-américaines. Très vite, elle développe un style unique, où le swing, le gospel et le jazz de cabaret fusionnent avec la sensualité du rhythm’n’blues.
Sa carrière prend son envol au sein du Jim Kweskin Jug Band, un groupe pionnier de la folk revival mêlant instruments acoustiques, washboards, kazoo et énergie pré-rock. Elle y rencontre Geoff Muldaur, guitariste et futur mari, avec qui elle enregistre plusieurs disques avant de se lancer, au début des années 1970, dans une aventure solo. En 1973 paraît son premier album, simplement intitulé Maria Muldaur — un disque qui marie la sophistication des arrangements west-coast à l’authenticité du blues et du folk. Le titre “Midnight at the Oasis”, léger et suggestif, devient un succès planétaire : un hymne sensuel, empreint d’une douce ironie, où la voix de Muldaur évoque à la fois Billie Holiday et Bonnie Raitt. Ce morceau, que l’on pourrait croire anecdotique, résume pourtant tout son art : la capacité à rendre populaire une musique profondément enracinée dans les traditions américaines sans la trahir.
Les années suivantes voient Maria Muldaur naviguer entre labels (Reprise, Warner, Stony Plain, Telarc, etc.) et esthétiques : blues acoustique, jazz vocal, gospel, swing rétro, new orleans funk. Son engagement dans la redécouverte du vieux répertoire féminin du blues — celui de Bessie Smith, Sippie Wallace ou Memphis Minnie — est remarquable. Là où d’autres cherchent la virtuosité, Muldaur revendique le charme du timbre et la vérité de l’interprétation. Sa voix, légèrement voilée, pleine de rires et de blessures, exprime la joie de chanter autant que la mémoire d’une Amérique métissée.
Au fil des décennies, elle s’impose comme une passeuse de mémoire. Ses albums Richland Woman Blues (2001) et Naughty, Bawdy & Blue (2007) sont de véritables hommages aux pionnières du blues féminin : orchestrations sobres, instrumentation d’époque, grain sonore patiné comme un vinyle. Mais Maria Muldaur ne se fige jamais dans la nostalgie. Elle collabore avec Dr. John, Bonnie Raitt, Taj Mahal, Mavis Staples ; elle chante du Bob Dylan (avec une sincérité bouleversante sur Heart of Mine, 2006) et même des chants gospel contemporains. Toujours ce mélange de ferveur et d’humour, de sensualité et de piété — une ambivalence qui fait d’elle une artiste atypique, à la croisée des chemins entre sensualité charnelle et spiritualité blues.
Ce qui frappe chez Maria Muldaur, c’est la cohérence d’un parcours traversé par la liberté. Elle n’a jamais cédé à la tentation de l’industrie, préférant les circuits indépendants, les labels à échelle humaine, les tournées intimistes. Dans un monde où les chanteuses de blues sont souvent réduites à des archétypes — la diva, la rebelle, la prêtresse — elle incarne une féminité plus nuancée : vive, libre, drôle, mais ancrée dans une mémoire. On peut voir en elle une sœur spirituelle de Bonnie Raitt, une héritière de Bessie Smith, ou une complice tardive de Norah Jones : une femme qui fait du blues un territoire intérieur, un mode d’expression du désir et de la résistance.
Aujourd’hui encore, à plus de 80 ans, Maria Muldaur continue de chanter avec une fraîcheur désarmante. Sa carrière, loin des projecteurs mais riche de plus de quarante albums, témoigne d’une fidélité rare à l’essence du blues et à la joie de la musique partagée. Elle appartient à cette génération d’artistes qui ont transformé la folk américaine en un espace de liberté et d’invention — et sa voix, toujours sensuelle, continue d’évoquer la nuit, la chaleur et la promesse du voyage.