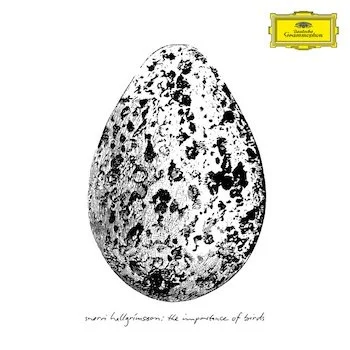Snorri Hallgrímsson
Parmi les compositeurs islandais de la nouvelle génération, Snorri Hallgrímsson s’impose comme une voix singulière, discrète mais d’une densité émotionnelle rare. Né à Reykjavik, formé d’abord comme guitariste classique avant de se tourner vers la composition et l’orchestration, il appartient à cette lignée nordique qui conjugue mélancolie, lenteur et clarté : une esthétique du silence habité, héritière de la nature islandaise autant que d’une introspection presque spirituelle. Si son nom reste moins célèbre que ceux d’Ólafur Arnalds ou Jóhann Jóhannsson, dont il fut longtemps le collaborateur, son œuvre se distingue par une tendresse mélodique et un raffinement harmonique qui lui confèrent une identité propre — plus intime, plus humaine.
Après avoir étudié au Berklee College of Music à Boston, Hallgrímsson s’installe à Londres, où il devient arrangeur et orchestrateur pour le cinéma et la télévision. Il participe à plusieurs projets de Jóhann Jóhannsson, notamment The Theory of Everything et Arrival, contribuant à la couleur orchestrale de ces bandes originales où se fondent cordes, chœurs et textures électroniques. Cette expérience le marque durablement : on retrouve chez lui cette science de l’équilibre entre l’organique et le synthétique, entre le souffle du quatuor à cordes et la résonance d’un pad éthéré.
Son premier album solo, Orbit (2018, Sony Masterworks), est une révélation. Construit comme une suite de miniatures suspendues, il s’inscrit dans la continuité de l’école islandaise post-minimaliste mais s’en démarque par une dimension plus narrative. Chaque pièce semble raconter un souvenir diffus, entre la nostalgie et la lumière. Les cordes (souvent enregistrées par un petit ensemble, dirigé par lui-même) sont mêlées à des textures électroniques presque imperceptibles ; les pianos scintillent comme des reflets sur la glace. On y perçoit un lyrisme feutré, plus proche de Arvo Pärt que de Nils Frahm, mais avec une fluidité harmonique d’un compositeur de musique de film. La pièce “Reflections” illustre bien ce climat : une montée lente, presque timide, vers une clarté apaisée.
Avec Landbrot (2023), Hallgrímsson approfondit cette écriture de la mémoire et du paysage. Le titre, emprunté à une région du sud de l’Islande, évoque la fissure terrestre, la fracture géologique comme métaphore du souvenir. Ici, les voix humaines deviennent instrumentales, les cordes respirent avec un naturel presque chorégraphique. Le disque frappe par sa pudeur : rien n’y est démonstratif, tout semble retenu, comme si la beauté devait être frôlée sans jamais être saisie. Ce second opus confirme que Hallgrímsson ne cherche pas la grandeur épique du néoclassicisme, mais une émotion patiente, intérieure, où le silence tient lieu de colonne vertébrale.
L’univers de Snorri Hallgrímsson est profondément visuel : il écrit comme on cadre un plan dans un film de Tarkovski — la lumière glisse, l’air circule, l’attente devient le moteur de la forme. Ses compositions semblent écouter le monde plus qu’elles ne le décrivent. Et c’est sans doute là que réside sa singularité : une musique de la respiration, de la consolation, où la mélodie se tient sur le fil fragile de l’émotion pure. Dans la prolifération actuelle du néo-classique atmosphérique, Hallgrímsson apporte un contrepoint de sincérité et de rigueur. Il n’enregistre pas pour remplir le silence, mais pour l’honorer.
Son parcours est encore jeune, mais déjà cohérent. De l’orchestration cinématographique à la méditation intime, il trace un chemin où l’Islande n’est pas seulement un décor, mais une manière de sentir : la lumière basse, les horizons ouverts, la solitude fertile. En cela, Snorri Hallgrímsson s’impose comme l’un des compositeurs les plus prometteurs de cette génération du Nord qui a redonné à la musique contemporaine sa fonction première : celle d’émouvoir sans artifice, de relier sans discours.